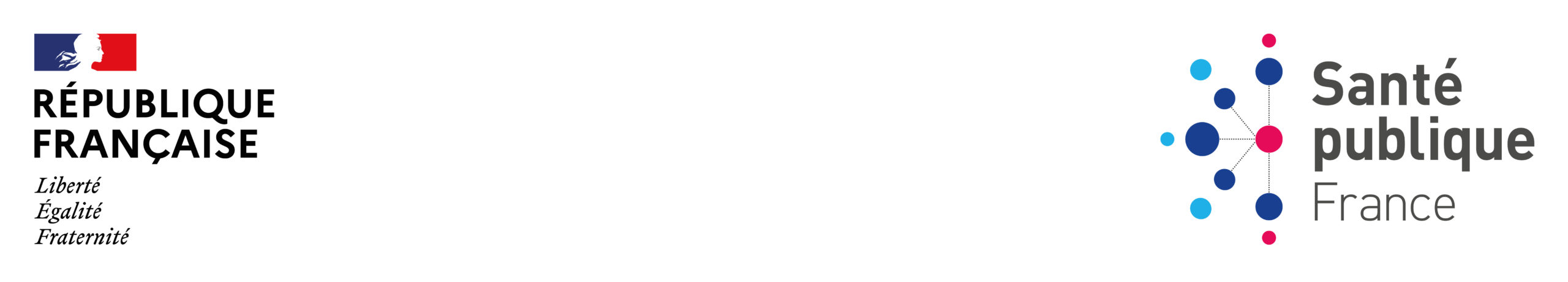Mercredi 21 juin
Pause
Écouter
- 10H00 - 10H15Ouverture
Ouverture officielle de la 2ème journée
Pr Christian Rabaud, directeur général de la Santé
- 10H15 - 12H15Plénière
Des déterminants individuels aux systèmes complexes : mieux comprendre les problématiques de santé publique
Session coordonnée par Pierre Arwidson, Direction de la Prévention et de la Promotion de la santé et Caroline Alleaume, Direction alerte et crise

Plénière proposée avec une traduction simultanée français/anglais Les choix alimentaires, le manque de sommeil, la sédentarité, le surpoids sont souvent identifiés comme des déterminants individuels influençant la santé. La session illustrera comment ceux-ci ne prennent pas leurs racines uniquement dans des choix personnels mais s’inscrivent dans un système complexe d’influences politiques, économiques, sociales, environnementales elles-mêmes interdépendantes. C’est donc pour resituer ces déterminants dans des contextes et un réseau d’influences, sur lesquels il est possible d’agir, que de nombreux travaux se sont attachés à formaliser ces différentes relations de causalités via de nouvelles approches. Celles-ci permettent d’appréhender des sujets de santé publique tels que le surpoids, le manque de sommeil ou encore l’addiction sous l’angle de l’organisation de nos environnements de vie et ainsi de construire des interventions collectives et de les évaluer au regard de leur impact sur la santé individuelle.
Pour illustrer ces recherches et leur apport à la prévention et la promotion de la santé, cette session reviendra sur le contexte d’émergence de ces approches, présentera différents exemples d’actions basées sur ces modèles complexes et montrera en quoi celles-ci constituent des opportunités d’actions qui améliorent les comportements individuels liés à la santé. Enfin, son appropriation par les acteurs publics pour la mise en œuvre de politique sera esquissée au travers de la présentation de dispositifs publics nationaux.
Replay (version française)
From individual determinants to complex systems: better understanding public health issues
Dietary choices, sleep disorders, sedentary lifestyle, and obesity are often identified as individual determinants influencing health. The session will illustrate how these determinants and related behaviours on the part of individuals are driven by complex networks of interdependent political, economic, social and environmental factors. In order to place these determinants in the context of this network of influences on which it is possible to act, an increasing number of studies have sought to formalize these different causal relationships through new approaches. These approaches allow us to understand public health issues such as overweight, sleep deprivation or addiction from the perspective of the organization of our living environments and thus to build collective interventions and to evaluate them in terms of their impact on individual health.
To illustrate this research and its contribution to prevention and health promotion, this session will review the context of the emergence of these approaches, present different examples of actions based on these complex models and show how they constitute opportunities for actions that improve individual health-related behaviours. Finally, its appropriation by public actors for policy implementation will be outlined through the presentation of national public schemes.
Replay (english version)
Modérateurs
Pierre Arwidson, Santé publique France
John Newton, Conseil scientifique Santé publique France
Introduction
- Pierre Arwidson, Santé publique France
Interventions
- Des choix individuels sous influences : l’intérêt d’une approche par les système complexes en santé publique
Individual choices under influence: the interest of complex systems approach in public health
Laetitia Huiart, Santé publique France
Télécharger la présentation - Des systèmes complexes pour résoudre des problèmes complexes de santé publique : du jeu de dames au jeu d’échec
Chess not chequers: complex systems methods for complex systems problems
Harry Rutter, Université de Bath, Royaume Uni
Télécharger la présentation - Approche socio-écologique des déterminants de la santé : de la recherche observationnelle à l’intervention à grande échelle
A socio-ecological approach to health determinants: from observational research to large-scale intervention
Camille Perchoux, LISER
Télécharger la présentation - Évaluation d’un système de prévention : exemple du programme français de lutte contre le tabagisme
Evaluation of a Prevention System: Example of the French Tobacco Control Program
Michele Cecchini, OCDE
Télécharger la présentation
Conclusion
- John Newton, Conseil scientifique, Santé publique France
- 12H00 - 14H00Pause
Pause déjeuner
- 14H00 - 16H45Session
Comment et pourquoi compter les décès aujourd'hui en France ?
Session coordonnée par Anne Fouillet, Direction appui, traitement et analyse des données

Sessions proposée avec une traduction simultanée français/anglais La mortalité est un indicateur épidémiologique incontournable, mesurant la sévérité et l’impact direct et indirect d’un évènement sur la population. La pandémie de COVID-19 a mis en évidence, au travers de la communication journalière du bilan des décès liés à l’épidémie, l’importance de disposer d’un indicateur de surveillance réactif, informatif, fiable et compréhensible de tous. La crise a également mis en exergue la complexité et les limites du dispositif français pour atteindre cet objectif.
Dans le contexte fortement marqué par la coexistence de crises sanitaires d’origines diverses, il est aujourd’hui nécessaire de dresser un état des lieux des données disponibles, des méthodologies d’analyse, des usages et des enjeux autour de l’utilisation des données de mortalité, que ce soit d’un point de vue scientifique, institutionnel ou de communication.
Cette session vise à aborder, avec les principales institutions en charge des données de mortalité et différents utilisateurs (décideurs aux niveaux national et régional, chercheurs, grand public…), ces différents points et préparer la surveillance de la mortalité de demain.
Replay (version française)
How and why are deaths counted in France today?
Mortality is an essential epidemiological indicator, measuring the severity and direct and indirect impact of an event on the population. The COVID-19 pandemic has highlighted the importance of having a reactive, informative, reliable and comprehensible monitoring indicator for everyone through daily reporting of deaths related to the epidemic. The crisis also highlighted the complexity and limitations of the French system to achieve this objective.
In the context strongly marked by the coexistence of health crises of various origins, it is now necessary to take stock of the available data, analysis methodologies, uses and challenges around the use of mortality data, whether from a scientific, institutional or communication point of view.
This session aims to discuss these various points with the main institutions responsible for mortality data and various users (decision-makers at national and regional levels, researchers, the general public, etc.) and prepare for the mortality monitoring of tomorrow.
Replay (english version)
Modératrices
Céline Caserio-Schönemann, Santé publique France
Bernadette Gergonne, Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA)
1ère partie – Comment compter les décès ?
- Introduction : panorama des différentes sources de données de mortalité
François Clanché, Drees
Télécharger la présentation - Zoom sur le certificat de décès : contenu et circuit
Elise Coudin, Inserm-CépiDc
Diane Martin, Inserm-CépiDc
Lionel Espinasse, Insee
Sylvie Le Minez, Insee
Télécharger la présentation - Comment compter les décès … en excès ? : Comparaison des stratégies d’analyse de la mortalité toutes causes
Nathalie Blanpain, Insee
Anne Fouillet, Santé publique France
Télécharger la présentation - Comment compter les décès …par cause ? Concepts et décodage des causes de décès
Diane Martin, Inserm – CépiDc
Zina Hebbache, Inserm – CépiDc
Télécharger la présentation - Tendances récentes de la mortalité selon la cause initiale
Elise Coudin, Inserm–CépiDc
Anne Fouillet, Santé publique France
Télécharger la présentation - Apport de la prise en compte des causes multiples à l’analyse de la mortalité
Aline Désesquelles, Ined
Télécharger la présentation
2ème partie – l’expérience de la COVID-19
- La surveillance de la mortalité en lien avec la COVID-19 au quotidien : résultats, forces et faiblesses
François Clanché, Drees
Céline Caserio Schönemann, Santé publique France
Télécharger la présentation - Comment d’autres pays ont suivi au quotidien la mortalité COVID-19 : expériences internationales
Jean-Marie Robine, Mécanismes Moléculaires dans les Démences Neurodégénératives (MMDN), Université de Montpellier, EPHE, Inserm U1198
Télécharger la présentation - Comment faire mieux dans le futur ? Apport de la certification électronique des décès
Anne Fouillet, Santé publique France
Télécharger la présentation
- Introduction : panorama des différentes sources de données de mortalité
- 14H00 - 16H45Session
Risques liés à l’exposition aux substances chimiques : de la surveillance nationale aux actions locales dans le cadre européen
Session coordonnée par Clémence Fillol, Céline Ménard, Yuriko Iwatsubo et Laëtitia Perrin, Direction santé environnement et travail
La population est exposée à une multitude de substances chimiques dans ses différents environnements (résidentiel, professionnel, …). L’exposition à ces substances peut avoir des effets néfastes sur la santé humaine. Dans le but d’évaluer les risques sanitaires en lien avec ces substances et de suivre les actions menées pour les réduire, la France et l’Union européenne sont engagées dans de nombreux projets.
Cette session propose de présenter des études examinant les effets sanitaires en lien avec les substances chimiques dont les perturbateurs endocriniens. Ce sera également l’occasion de présenter le projet européen PARC qui participe à la stratégie pour un développement durable vers un environnement sans substances toxiques afin de mieux protéger la santé humaine et l’environnement. Seront aussi présentées des initiatives locales cherchant à réduire la présence des substances chimiques, et les enjeux inhérents à leur mise en œuvre.
Replay
Modérateurs
Thierry Cardoso, Santé publique France
Catherine Viguié, Inrae
1ère partie – Interventions
- Comment le projet européen PARC peut-il venir en appui aux politiques publiques sur les substances chimiques ?
Christophe Rousselle, Anses
Télécharger la présentation - Surveillance intégrée des pathologies en lien avec les perturbateurs endocriniens : premiers résultats de la priorisation des effets sanitaires
Julien Caudeville, Santé publique France
Télécharger la présentation - Expositions précoces à un mélange de phénols et phtalates et comportement social dans la cohorte SEPAGES
Claire Philippat, Inserm, Université de Grenoble
Télécharger la présentation - Actions locales pour une politique de sobriété chimique : exemples de programmes de transition des villes à l’échelle des établissements accueillant de jeunes enfants
Anne Lafourcade, SAFeLi-ALICSE
Télécharger la présentation
2ème partie – Table ronde : Comment protéger la population face à l’exposition aux substances chimiques ?
En présence de :
- Gwenaëlle Hivert, ARS Pays de la Loire
- Jean-Marc Brignon, Ineris
- Caroline Paul, Direction générale de la santé
- Agnès Verrier, Santé publique France
- Elisa Thil, Ville de Strasbourg
Conclusion
Télécharger la présentation - Comment le projet européen PARC peut-il venir en appui aux politiques publiques sur les substances chimiques ?
- 14H00 - 16H45Session
Programmes de prévention : comment et pourquoi mesurer leur performance avec les méthodes quantitatives ?
Session coordonnée par Cécile Sommen, Direction, appui, traitement et analyse des données
Malgré plus de 50 ans de recherche et la documentation en continue de registres internationaux en prévention, les interventions dans le domaine de la prévention en santé sont souvent mises en place sans s’appuyer sur des méthodologies ayant déjà montré leur efficacité, ou sans prévoir l’évaluation de leur impact. Pourtant, ces évaluations sont indispensables pour mesurer la performance d’une intervention et identifier celles susceptibles d’être efficaces. Les méthodes quantitatives sont adaptées pour répondre à ce besoin car elles permettent de se placer dans un cadre bien défini et reproductible.
L’objectif de cette session est de présenter différentes méthodes d’évaluation d’interventions de prévention sur des populations différentes, de discuter des difficultés méthodologiques liées à la mise en place des interventions, à leur évaluation et à leur reproductibilité. Nous discuterons également dans une table ronde de la mise en place d’évaluations systématiques au niveau national et international.
Replay
Modérateurs
Pierre Arwidson, Santé publique France
Judith Van Der Waerden, Inserm
1ère partie – Interventions
- Le programme UNPLUGGED : analyse du parcours de réalisation, évaluation et dissémination à l’échelle européenne d’un programme de prévention des dépendances en milieu scolaire
Fabrizio Faggiano, Université du Piémont oriental
Télécharger la présentation - Impact de l’implantation du programme EMMIE (Entretien Motivationnel en Maternité pour l’Immunisation des Enfants) au Québec
Arnaud Gagneur, Université de Sherbrooke
Télécharger la présentation - Tentatives de suicide : prévenir la récidive, l’évaluation du dispositif VigilanS à partir des données du SNDS et d’Oscour
Yves Gallien, Santé publique France
Sandrine Broussouloux, Santé publique France
Télécharger la présentation - Évaluation d’efficacité d’une campagne médiatique de prévention : l’exemple de la campagne sur les « ravages » de l’alcool
Guillemette Quatremère, Santé publique France
Romain Guignard, Santé publique France
Télécharger la présentation
2ème partie – Table ronde : Les défis de la mise en place d’actions de prévention efficaces en France : faut-il créer de nouvelles interventions et les évaluer, ou disséminer des interventions déjà évaluées comme efficaces ?
- Quels sont, à votre avis, les principaux enjeux / défis dans la mise en place d’évaluation quantitative des actions de prévention ? (Protocole, compétences, financement, durée)
- Quelles sont les étapes à mettre en place après qu’une intervention de prévention a été évaluée comme étant efficace ?
- Comment choisir quelles interventions de prévention créées par des équipes de terrain devraient bénéficier d’une évaluation quantitative de grande qualité ?
En présence de :
- Fabrizio Faggiano, Université du Piémont oriental
- Fabienne El-Khoury, Inserm
- Olivier Reilhes, ARS Paca
- Lauriane Ramalli, Santé publique France
- Le programme UNPLUGGED : analyse du parcours de réalisation, évaluation et dissémination à l’échelle européenne d’un programme de prévention des dépendances en milieu scolaire
- 14H00 - 16H45Session
Stratégie nationale pour renforcer les compétences psychosociales (CPS) des enfants et des jeunes : déploiement de l’expertise pour des interventions de qualité
Session coordonnée par Nadine Frery, Direction de la Prévention et Promotion de la Santé
Les compétences psychosociales (ou CPS) constituent un facteur clé de la santé globale et de la réussite éducative et sociale. Regroupant des compétences cognitives, émotionnelles et sociales, elles favorisent le bien-être de l’individu (par la régulation émotionnelle, la gestion du stress, les relations positives avec autrui, la prise de décision, la capacité à refuser…), la réduction de facteurs de risque (comportements violents, échec scolaire, conduites addictives, …) et le « Vivre ensemble ».
Une stratégie nationale interministérielle se met en place pour les 15 ans à venir pour renforcer les compétences psychosociales des enfants et des jeunes (3-25 ans) avec tous les ministères concernés, dans tous les milieux et sur tout le territoire. Associée à cette stratégie, Santé publique France apporte son expertise sur les CPS et soutient le déploiement d’interventions CPS (de type psychoéducatif) sur tout le territoire.
Comment déployer l’expertise CPS sur tout le territoire dans les différents secteurs, tout en permettant la dissémination d’interventions de qualité ? Comment assurer des formations CPS de qualité, en partageant un langage commun ?Cette session portera dans un premier temps sur la notion de CPS (définition, classification et facteurs d’efficacité d’interventions CPS), puis sur la stratégie nationale sur les CPS par la DGS et la DGESCO, et l’action de Santé publique France, illustrée par une courte vidéo d’interventions CPS auprès des enfants. Une table ronde avec divers intervenants portera sur le déploiement de l’expertise pour des formations CPS de qualité (représentants du monde universitaire, de l’Education nationale, d’ARS, d’IREPS/FNES et de Santé publique France).
Replay
1ère partie – Interventions
Modératrices
Dominique Jeannel, Santé publique France
Christine Ferron, Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santé- Introduction de la session CPS
Nadine Fréry, Santé publique France
- Les compétences psychosociales (CPS) : de quoi parle-t-on ?
Nadine Fréry, Santé publique France
Télécharger la présentation - La stratégie nationale de développement des CPS : un cadre d’action porté par une ambition partagée
Julie Barrois, direction générale de la Santé, ministère de la Santé et de la Prévention
Télécharger la présentation - Apport de l’expertise dans la stratégie nationale par Santé publique France
Nadine Fréry, Santé publique France
Télécharger la présentation - La stratégie de déploiement des CPS dans le cadre de la démarche « école promotrice de santé »
Claire Bey, direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO), ministère de l’Éducation nationale et de la Jeunesse
Télécharger la présentation
2ème partie – Table ronde : « Comment déployer l’expertise pour des interventions de qualité afin de renforcer les compétences psychosociales des enfants et des jeunes ? »
Modératrices
Nadine Fréry, Santé publique France
Christine Ferron, Fédération nationale d’éducation et de promotion de la santéEn présence de :
- Christophe Marsollier, Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche
- Magali Segrétain, IREPS Pays de la Loire
Télécharger la présentation - Rebecca Shankland, Université Lumière Lyon 2, responsable de l’Observatoire du bien-être à l’École
Télécharger la présentation - Aurélie Tardy, ARS Paca
Télécharger la présentation
- Introduction de la session CPS
- 14H00 - 16H45Session
Politiques environnementales et santé publique dans les territoires : préservons la santé des générations présentes et futures
Session coordonnée par Pascal Jehannin et Valérie Henry, Direction des régions et Anne-Juliette Serry, Direction de la Prévention et de la Promotion de la Santé

Sessions proposée avec une traduction simultanée français/anglais Le concept d’urbanisme favorable à la santé (UFS) est apparu au début des années 2000, notamment par le Réseau européen des Villes santé OMS. Il repose sur des choix d’aménagement et d’urbanisme qui promeuvent la santé et le bien-être des populations.
En 2023 où en sommes-nous des nouvelles recommandations, de l’appropriation de celles-ci et de l’acculturation par les différents acteurs et décideurs à l’heure de la 4ème édition des plans régionaux santé environnement et quels sont les bénéfices pour la santé humaine ?
Cette session proposera des réponses à ces questions par la présentation d’expériences dans les territoires en France et à l’étranger et par la présentation de travaux qui visent à démontrer que ce qui est bon pour le climat est également bon pour la santé humaine.
Replay (version française)
Environmental policies and public health in territories: preserving the health of today and tomorrow’s generations
The concept of healthy urban planning (HUP) emerged in the early 2000s, particularly by the WHO European Healthy Cities Network. It is based on planning and urban development choices that promote the health and well-being of populations.
In 2023, where do we stand with regard to the new recommendations, their appropriation and acculturation by the various players and decision-makers at the time of the 4th edition of the regional health and environment plans, and what are the benefits for human health?
This session will offer answers to these questions by presenting experiences in France and abroad and by presenting work that aims to demonstrate that what is good for the climate is also good for human health.
Replay (english version)
Modérateurs
Pascal Jehannin, Santé publique France
Jean Simos, UNIGE Genève, Suisse
Télécharger la présentation
Interventions
- Réseau français Villes-Santé. Alimentation saine et activité physique : les villes et intercommunalités actrices en promotion de la santé
Yannick Nadesan, Réseau français Villes-Santé OMS
Télécharger la présentation - Marche et vélo, bénéfices pour la santé humaine
Kévin Jean, Conservatoire national des arts et métiers
Télécharger la présentation - UFS entre ingénierie et opportunité
Brice Van Haaren, ADEUS Strasbourg
Télécharger la présentation - Urbanisme favorable à la santé : plaidoyer et appui aux collectivités, l’expérience de l’ARS ARA
Valérie Parron, ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Télécharger la présentation - La santé pour tous : Camélias Santé, un projet territorialisé de promotion de la santé, de 2018 à l’horizon 2030
Diane Bailleux, La Mutualité française, La Réunion
Télécharger la présentation - Utrecht : Healthy urban living for everyone
Miriam Weber, Ville d’Utrecht
Télécharger la présentation
Conclusion
- Jean Simos, UNIGE Genève, Suisse
- Réseau français Villes-Santé. Alimentation saine et activité physique : les villes et intercommunalités actrices en promotion de la santé